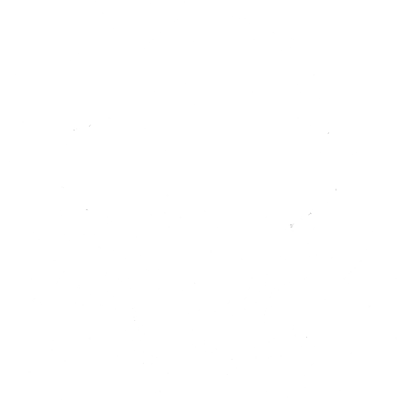:))))))))))))
Sorti en France il y a peu et dans une incompréhensible discrétion, le premier film de Boots Riley électrocute par son humour décapant aux recours illimités, par l’euphorie d’une mise en scène folle d’inventivité et enfin, par la puissance vitriolesque d’un « message » diplomatique comme un cocktail molotov lancé conjointement à l’exploitation capitaliste, la domination blanche et la police. On kiffe. On applaudit. On recommande.
Parce qu’il suffit de traverser la rue pour trouver un job (1), et parce que les pauvres ne sont pas des prolétaires exploités mais des millionnaires momentanément empêchés (2), Cassius Green (Lakeith Stansfield) commence sa carrière de démarcheur téléphonique avec le sourire extatique du winner débordant de motivation. Pourtant les raisons de flamber ne se bousculent pas au portillon : l’oncle (Terry Crews) dont il squatte le garage, endetté, se voit annoncer son expulsion imminente, sans qu’il n’ait de plans clairs pour le futur, malgré l’amour de Detroit (Tessa Thomson) et l’amitié de Salvador (Jermaine Fowler) qui, tout comme lui, enchaînent les petits boulots et les galères.

Parce qu’il ne s’agit pas d’un drame social mais d’une satire d’anticipation, les États-Unis sont le théâtre d’un mouvement social de grande ampleur, au sein duquel sévissent des milices subversives pratiquant l’action directe et stimulant les grèves partout dans le pays. Bientôt, au sein de son entreprise, Cassius se rapproche du leader syndical, Squeeze (Steven Yeun), qui entend bien imposer hausses des salaires et amélioration des conditions de travail à leurs employeurs par le rapport de force et la cessation d’activité. Car c’est à la chaîne que Cassius et ses collègues, minutés par l’entreprise, décrochent leurs téléphones, composent un nouveau numéro, prononcent « hello, sorry to bother you » (3), avant de s’entendre raccrocher au nez et d’inlassablement recommencer.
Jusqu’au jour où, sous les traits pleins de sagesse et de malice de Danny Glover, son compagnon de cabine lui suggère d’utiliser sa « voix de Blanc » pour passer ses coups de fil. Sa voix de Blanc? Mais oui, cette voix décontractée et étrangère à tout complexe, dans laquelle l’interlocuteur n’identifiera que la sonorité cheesy du winner exalté. Bingo! Armé de sa voix de Blanc, Cash (c’est le prémonitoire surnom de Cassius) devient bientôt la star de sa boîte. À l’heure où se profile la grève, préférera-t-il rester solidaire de ses camarades de classe, ou se laissera-t-il convaincre par les mirages d’ascension sociale que lui font miroiter ses employeurs?

Il faut le dire sans plus attendre : lorsqu’arrive du pays des sinistres Spielberg, Lucas et Nolan, un semblable brûlot anticapitaliste sans filtre, il y a de quoi sabrer la vodka. Sans filtre mais pas sans satire : là où la majorité des cinéastes engagés s’en tiennent à un réalisme strict, à un ton dramatique et à des vérités assénées comme de pontifiants sermons, Boots Riley préfère tremper cette farce sociale dans les trouvailles espiègles d’une mise en scène génialement déjantée. Convoquant Godard comme Gondry, il déploie tout au long du film un humour grinçant qu’aucune convention de goût ne semble pouvoir arrêter. Bonne pioche : si Sorry To Bother You laisse littéralement sur les rotules, c’est parce qu’il décide de ne pas choisir entre l’humour hyperbolique et la radicalité d’un propos délibérément agit-prop. C’est que le réalisateur veille toujours à ce que l’humour corrosif tout comme les exagérations cinématographiques demeurent toujours, malgré tout, proches du réel dont il est question : l’hyperbole plutôt que la fantaisie, le rire gêné plutôt que la pantalonnade à rires enregistrés.
Toujours sur le fil du rasoir entre le sérieux et le grotesque, Sorry To Bother You impressionne par la maîtrise avec laquelle s’enchaînent les situations paroxystiques, comme dans un continuel dérapage dont on se demande jusqu’à l’écran final s’il est contrôlé —un peu à la manière des films burlesque de l’héroïque temps du cinéma muet, RIP gentil cinéma parti trop tôt… Car outre la voix de Blanc calée sur les lèvres de Cash et les appels téléphoniques filmés comme des téléportations, les boucles d’oreilles et les T-shirts de Detroit (dont le mythique imprimé « future is female ejaculation ») filmés avec une insistance complice, on croisera également des humains prenant plaisir à s’entre-humilier dans des émissions de télé-réalité ou encore des humains modifiés génétiquement pour mieux travailler.

Mais si la bombe de Boots Riley frappe juste, c’est surtout qu’elle s’appuie sur le propre vécu du cinéaste, télémarketteur dans sa jeunesse, et en détaille avec délectation les moindres recoins : la vaine fierté que l’on éprouve à obtenir de bons résultats, la rage que l’on met à devenir « employé du mois », le détournement du langage qui permet de faire passer l’esclavage comme une opportunité de ne plus se faire de souci pour son logement ni pour ses repas, ou la trahison comme une occasion de valoriser son potentiel individuel. Et enfin, les mille subterfuges par lesquels on peut s’arranger avec sa conscience pour pouvoir se transformer en un déchet humain en ayant la sensation de réussir.
Car la double conscience, qui conduit Cash à se « blanchir » pour devenir un gagnant, est bel et bien au centre du film, et s’étale avec la même précision clinique et la même jubilatoire finesse que dans Get Out de Jordan Peele. Écho de Peau Noire, Masques Blancs de Frantz Fanon, l’un comme l’autre montrent les promesses d’une égalité raciale par la réussite économique comme un évident mirage, non pas seulement parce que les Blancs sont déjà les gagnants du monde capitaliste, mais également parce que la réussite d’un Noir ne peut s’y produire qu’au prix d’un reniement de son propre vécu, de ce qui le relie à celles et ceux dont il partage la condition, la démarche physique, la manière de voir le monde. À l’impossible blanchissement répond symétriquement l’impossible ascension sociale décomplexée, imbriquant ainsi le combat pour la justice sociale et celui pour l’égalité raciale.

En d’autres termes, Sorry To Bother You est l’antithèse absolue du nullissime BlacKKKlansman : là où dans la daube de Spike Lee un keuf Blanc remplaçait dans la vraie vie un keuf Noir pour faire face, ensemble, à un Ku Klux Klan composé d’idiots caricaturaux, le film de Boots Riley est construit autour d’un personnage qui possède les deux voix, celle du travailleur Noir et celui du winner Blanc. Entre les deux, le choix lui appartient.
Voir un film indépendant aussi ambitieux politiquement et mené avec tant de fougue et de folie, être si confidentiellement dans les salles françaises ne peut que laisser songeur quand on pense aux concerts de louanges qui accompagnent le moindre prout raciste de Clint Eastwood ou la vacuité sans cesse croissante des œuvres de Monseigneur Tarantino. Il est encore temps. Allez-y. Plusieurs fois d’affilée. Avec vos ami.e.s, vos amours, vos camarades.
- (1) La vanne est d’Emmanuel Macron®, vuvuzela-en-chef de la politique-spectacle hexagonale, comique troupier et banquier d’affaires.
- (2) La remarque est de John Steinbeck : « Le socialisme n’a jamais pris racine aux USA parce que les pauvres se voient non comme un prolétariat exploité, mais comme des millionnaires temporairement empêchés ».
- (3) C’est de l’anglais : « bonjour, désolé de vous déranger ».
Boots Riley is made for fighting : so “Sorry To Bother You”.
Fév 2019