Conversation: ‘La dernière farce’ d’Emmanuel Carpentier
Il y a des poèmes qui vous atteignent avec la force de l’évidence et semblent composés pour être entonnés en chœur.
D’autres préfèrent jouer avec le lecteur au chat et à la souris, le traquer, le perdre, le frapper là où il ne s’y attend pas.
La Dernière Farce d’Emmanuel Carpentier, récemment paru chez l’Harmattan, est de cette seconde famille : après une première partie en forme de flux de conscience kaléidoscopique où une femme observe sous toutes ses facettes la perte de l’être aimé, la seconde partie du tableau voit se succéder des climax pervers, provocants et porteurs d’interrogations vertigineuses, prenant à parti tant le lecteur que la littérature elle-même dans l’éclat d’une pièce punk et désespérée. Emmanuel Carpentier hante aussi bien les nuits de Pigalle que celles du Club des Poètes. On l’y connaît en dandy épris de spiritualité ou en pourfendeur de la flicaille parisienne, c’est pourtant de jour et autour d’un thé que l’on se retrouve pour parler de ce premier texte publié par un auteur à la plume abondante.
Emmanuel Carpentier : J’ai écrit ce texte il y a maintenant huit ans, à une époque où j’étais bien plus poète que je ne le suis aujourd’hui. Je venais de terminer des études de cinéma, que j’avais choisies car je sens depuis toujours un regard braqué sur moi : le cinéma m’a semblé tout à fait adapté à l’exploration de ce regard. Depuis, j’ai découvert que c’était le thème de la fascination qui me poursuivait, et traduisait ce regard. Je travaillais dans la production de films, et tous les soirs, j’écrivais. Des notes, sur lesquelles parfois je revenais. C’étaient parfois des réflexions un peu conceptuelles, puis les concepts sont peu à peu devenus des personnages : on y voit notamment un punk qui enfonce des caisses vides ou encore s’insère dans un colis piégé dans une gare. Tout cela partait de considérations sur par exemple le dehors / le dedans, le vide, ce qui conduit à des histoires un peu abracadabrantes, qui ont un retentissement presque métaphysique

©Hannibal Volkoff
MauvaisMagazine : La Dernière Farce est présenté comme de la poésie. Cela pourrait être tout autant de la philosophie en situation, ou un récit façon flux de conscience. Pourquoi choisir d’écrire depuis la poésie ?
Tout simplement parce que c’est là ma première intention. Aujourd’hui je m’intéresse à la philosophie : ce n’était pas du tout le cas à l’époque. Je voulais écrire un texte dont l’existence pose problème. Il s’agissait de faire ce que je disais, en quelque sorte, essayer d’atteindre par le langage le concept, parvenir à une adéquation entre le langage et les paroles, entre le réel et l’irréel. Je voulais que ce livre marque une fissure, et aspire à la totalité.
Mais quelle est la spécificité, dans cette entreprise, du langage poétique par rapport, par exemple, à la prose du récit ?
Il n’y a pas de prise de parti : je ne demande pas au lecteur de faire des concessions, ni d’accepter un parti-pris narratif comme dans un roman. Je veux dresser à la face du lecteur quelque chose qui a tout d’un objet mais n’en est pas un, car le lecteur ne peut pas être face à lui simplement un sujet. La frontière est délibérément toujours brouillée entre le texte, celui qui lit, ce qui est lu, le mot, ce qu’il désigne… Dès que le texte s’affirme comme sens, tout de suite le sens se perd. C’est sans doute sous cet aspect là que le texte dérange.
Dans ta première partie, mélancolique, nous voguons dans le flux de conscience d’une jeune femme qui a perdu son amant, Aurel, et dont les réflexions semblent explorer chaque face d’une pierre aux côtés innombrables. Cette multiplicité des facettes que tu explores donne la sensation que tu cherches à saisir la totalité de l’expérience littéraire : non plus seulement un récit à la troisième personne, comme dans le roman classique, non plus une première personne conquérante, ni un commentaire sur l’écriture ou la lecture comme le vingtième siècle en a regorgé, mais bien tout cela à la fois, fuyant sans cesse d’une question à une autre.
C’est effectivement un enchâssement perpétuel : la personne qui parle est absorbée dans un méta-discours qui se perd à son tour, sans fin, il y a des couches multiples, et aucun discours final, si ce n’est l’idée d’une perte, d’une perte générale, l’idée qu’il faut que le langage se perde pour vivre. Le langage, les mots, l’écriture doivent se perdre, se disséminer partout dans le monde, pour qu’on les recherche, pour qu’ils renaissent, pour qu’ils se métamorphosent sans cesse. Il en va de même pour les supports du texte : la page, le papier, tout ce qui vient légitimer la littérature, discours comme institutions : tout cela, doit se perdre, telle est l’ambition. La perte et non pas la disparition, que je lui oppose comme inconcevable. La perte permet que l’on aille chercher à nouveau ce que l’on a perdu.

Il y a une ambiguïté : d’un côté il y a l’idée de la perte, et de l’autre côté, tu assumes l’ambition littéraire d’être celui qui fixe cette idée dans un texte. Tu y prends donc ta part, tout en en voyant les limites ?
J’en reviens à la manière dont j’ai composé ce texte. Le hasard y a totalement sa place. Je ne l’ai pas écrit de manière linéaire ni préméditée. J’ai pris des notes pendant longtemps, puis les ai rassemblées,en préservant tout ce que le hasard permet comme associations. En cela, ça se rapproche de la peinture, avec laquelle il ambitionne de se mesurer. C’est un discours morcelé, qui se déploie par bribes, éparpillées au hasard.
Il y a tout de même une structure en diptyque. D’abord, un flux de conscience quasiment philosophique, qui tourne autour de la perte. Pourquoi l’avoir installé en préambule à cette seconde partie, explosive ? C’est comme si dans la première partie on tournait autour, et dans la seconde on passait à travers…
Après avoir cherché de manière presque romantique ce que l’on a perdu, au cours d’un discours encore teinté de sentiments, où l’amour et les sentiments sont au coeur du texte, on arrive à un second acte punk, où on ne tourne pas autour du sujet mais va le défoncer comme une caisse vide, comme exploserait un colis piégé. Le punk ne veut pas savoir s’il est aimé en retour, il n’a plus d’intériorité et assume son vide intérieur, mais qui pour exister a besoin de rentrer en contact avec d’autres vides, de les faire s’entrechoquer, et c’est à ce prix qu’il existe. Il y a une phrase qui dit : « il s’enfonce ainsi dans l’absence de futur et le temps est prolongé de quelques secondes ».
Que représente pour toi la perte, thème central de la première partie ?
J’en ai fait quelque chose de quasiment mystique, que j’oppose à l’idée de disparition, qui est proprement inconcevable. Si l’on est croyant, un être ne disparaît pas. Il se perd, mais on peut partout le retrouver. La perte, c’est la dispersion de l’objet perdu. Si je perds mon briquet dans ma chambre et entreprends sa recherche, l’espace entier s’éveille et j’y découvrirai des zones que je n’ai jamais explorées. La perte porte en elle la recherche de ce qui a été essaimé, disséminé de par le monde, c’est ce qui en fait quelque chose de quasiment mystique, là où la disparition est nihiliste.
Le second volet serait celui de la perte de soi, tandis que le premier tourne autour de la perte de l’autre.
Voire simplement la disparition, telle que je la définis : comme quelque chose d’inconcevable, qui n’existe pas et plonge dans la psychose. Un garçon parle tout seul dans sa chambre à des choses qui n’existent pas lorsqu’il s’aperçoit de leur non-existence se fait interner en hôpital psychiatrique. Il n’y a ici plus aucun mysticisme, mais au contraire une forme d’athéisme, d’autant plus vivant.

Dans la seconde partie, l’hôpital psychiatrique apparaît clairement comme un purgatoire de la modernité, comme une soupape de sécurité entre la conscience de l’absurde et la vie en société. Dans la première, ta narratrice – qui affirme justement qu’elle pourrait « braver le monde moderne » – semble vouloir, à travers la perpétuelle reformulation de ses pensées, comme un kaléidoscope interminable, conjurer un mensonge auquel la modernité ferait écran. Quel est ton rapport à la modernité ?
Dans la première partie, au cours de laquelle subsiste l’espoir de retrouver ce qui a été perdu, la modernité est envisagée comme une gigantesque perte : du sens, du langage, du signifié. Une dispersion générale des objets, une perte de tout support qui pourrait légitimer la parole – on pourrait l’illustrer avec l’arrivée d’internet par exemple, et la réduction de tout à de l’information. Il en résulte un système totalement immanent. Dans la première partie, il y a dans la foi de la narratrice la possibilité d’explorer le monde et sa propre pensée, et l’idée d’un retour et d’un voyage.
D’un pari également, qui devient bientôt intenable
Oui, jusqu’au moment où elle retrouve son amant dans le lecteur, qui sauve le texte. Il s’agit d’un livre qui demande à être sauvé en permanence. Dans la lecture du texte se trouve la dernière communion possible. Dans la seconde partie, cet espoir n’existe pas, et face à l’absurde, il ne demeure plus que la violence et le désir d’action. Non plus pour sauver le monde, mais pour sauver ce livre-là, l’objet, ce qui est en rapport direct avec nous. On ne sauve plus que le face à face.

Tu as été confronté à la perte de manière intime.
Oui. J’y ai répondu par le contact avec le milieu de la psychiatrie, que je vois comme un monde où macèrent les choses, un monde quasi-édénique, purgé du bien et du mal, où l’on ne croit pas plus en nous, patients, qu’en notre discours. Tout est égalisé, aseptisé, il n’y a plus de querelle entre le Bien et le Mal, une totale innocence.
C’est d’ailleurs parfois un peu effrayant. L’un des aspects centraux de ton texte consiste à poser la question d’un continuum possible entre l’humain et l’objet inerte. Cet aspect culmine lors des l’évocation de l’hôpital psychiatrique, où l’humain est ramené à rien, situation présentée comme édénique.
Concernant la psychiatrie, comme monde édénique où néanmoins l’on souffre. Bien qu’on n’y croit pas plus en nous qu’en notre discours, on s’y sent néanmoins légitimé. De nombreuses personnes que j’ai connues, confrontées à cet univers-là s’y sont senties légitimées. Bien que tout devienne symptôme, à commencer par ce que l’on pense et ce que l’on dit, il s’y trouve une légitimation de ce que l’on est, de ce que l’on vit dans l’instant, de ce dont on souffre.
Par quoi passe cette légitimation ?
Par un changement total de cadre, qui fait que nous sommes face à des médecins ou des infirmiers, qui prennent note de tout ce que l’on dit. Ce n’est pas facile de dire précisément le noeud de cette expérience, sauf à dire que la souffrance est prise en charge, la notion de « faute » est évacuée. On n’est plus coupable. On est traversé par la souffrance, voilà tout.
Est-ce que tu coup il ne reste plus d’autre issue désirable qu’une sorte d’un effacement, d’une renonciation au désir de vivre, comme une sorte de bouddhisme à la sauce Schopenhauer ?
Je parlerais plutôt d’un stade de psychose où il n’y a plus vraiment de Moi. Dans l’Anti-Oedipe, Deleuze affirme que le schizophrène est peut-être le seul individu qui soit sauvé dans notre société. Le schizophrène est, selon lui, la négation du capitalisme par le capitalisme lui-même. Il épouse le même mouvement que celui du capitalisme, mais il le pousse jusqu’à sa négation. Je parlerais donc plus volontiers de dilution que d’effacement. Une sorte de dilution dans l’objet, pour parvenir à une vie réellement objective, au sens plein du terme, d’où il découle un « bonheur sans nous ».

Le terme de cette objectivation est atteint dans la scène du viol dans la deuxième partie. Il s’agit d’un symptôme comme d’une réponse à cette objectivation. La sensation de la victime est volontairement laissée dans le hors-champ, comme chez le Sade des 120 journées de Sodome, mais sans la notion de plaisir tortionnaire. Pourquoi ?
Entendons-nous : il ne s’agit en aucun cas de légitimer le viol en tant que tel, encore moins de délégitimer les victimes. Mais ce dont il est question ici, c’est d’un monde sans faute, sans culpabilité, donc sans crime, même lorsque la violence fait irruption. Du reste, dans cette seconde partie, nous n’avons pas affaire à des personnages, mais à des figures, certes indissociables de ceux qui les portent, quand bien-même ceux-ci n’existent pas réellement. C’est pourquoi les prénoms sont orthographiés phonétiquement. Cette distinction est cruciale. Ce que décrit cette scène, d’ailleurs, va plus loin que le viol : le regard est progressivement détourné vers la rue, vers les passants qui se réveillent, de sorte que de ce viol, qui implique des personnages vides, il ne résultera rien. A cette absence de conséquences s’ajoute l’absence de jugement, et l’absence de compassion. Le lecteur est placé dans une situation ambiguë, pas loin de la complicité morbide. L’innocence pour les figures du texte, le trouble pour le lecteur. Voilà ce dont il s’agit. Et c’est là qu’intervient la notion de fascination. Un moment où la bipolarisation entre sujet et objet n’a plus cours. Il n’y a plus d’intentionnalité, mais au contraire une nudité et une virtualité totale de l’acte qui fascine, sans cause ni effet.
Cette scène répond à une autre, toujours dans la seconde partie, celle de l’explosion du colis piégé. Les figures qui habitent ce texte, peut-être du fait de leur manque d’intériorité, sont en conflit avec le monde : tantôt celui-ci s’impose à elles (auquel cas, elles finiront en hôpital psychiatrique), tantôt ce sont eux qui s’imposeront au monde – par le biais de l’action terroriste.
Parfaitement. Il y a aussi une autre scène de meurtre, appelée à être éternellement réitérée, et donc éternellement insatisfaisante.
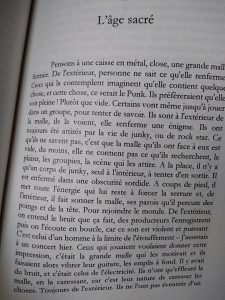
Tu parles du punk comme d’une valise vide, et que l’on ne comprend pas en tournant autour mais en frappant un grand coup dedans.
Oui, les punks ne cherchaient pas à être des punks, à l’origine. Il y a un camé qui essaie de sortir de cette valise où il est enfermé en tapant de toutes ses forces contre les parois. Autour, des gens s’amassent, mais ne peuvent pas comprendre.
Un peu à la manière du texte, qui tourne autour de quelque chose d’insaisissable ?
Oui, à cette différence près que dans le texte, la fascination intervient.
Peut-on réellement à la fois parler de la fascination comme idée, et la susciter sur le plan littéraire ? J’ai l’impression que le texte alerte sur une fascination que l’on ne pourra trouver qu’en-dehors de lui, dans la vie hors de la littérature…
Certes, mais en s’imposant comme objet, il ne peut être que fascinant : il ne peut pas être saisi, utilisé, récupéré ni même perçu. Ne reste que la fascination.
Propos recueillis par Syd Alexander, œuvre pictural d’Emmanuel Carpentier.

Pensées . Poésie
Conversation: ‘La dernière farce’ d’Emmanuel Carpentier
Par syd
Juil 2018



