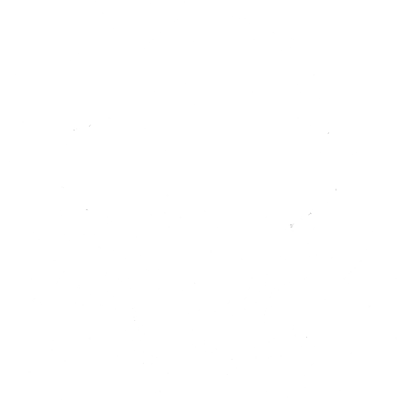:))))))))))))
Un petit plaisantin s’est amusé à signer du nom prestigieux de l’auteur de Do The Right Thing un film à la gloire de la police, qui serait aux États-Unis l’alliée objective des luttes de libération des noirs face à la montée du suprémacisme blanc. Au secours!
La promesse semblait trop belle : l’histoire vraie d’un flic noir qui infiltre le Ku Klux Klan, célèbre organisation de suprémacistes blancs cagoulés, prompts à lyncher des noirs et à brûler des croix, et dont certaines figures historiques ne cachent pas leur proximité avec l’actuel président des États-Unis, Donald J. Trump. On allait voir ce qu’on allait voir. Accrochez vos ceintures, ça va secouer. Bienvenue dans BlacKKKlansman.
* Cet article dévoile certains aspects de l’intrigue du film *
Afin de planter le décor, le nouveau « Spike Lee Joint » précise d’emblée qu’il se base sur des « f…ing true facts » (sur des « putain de faits réels », parce que quand on écrit « putain » on a l’air cool, djeunz, câblé). Lesquels sont les suivants : en 1978, un jeune homme noir, le dénommé Ron Stallworth, réalise son rêve d’enfant en devenant le premier flic noir de Colorado Springs. Pour bien démarrer dans son merveilleux métier, il infiltre la section locale étudiante des Black Panthers lors de la venue de Kwame Ture (1). Joignant l’utile à l’agréable, il entame rapidement une idylle avec Patrice, la présidente du mouvement. Mais comme les Panthers semblent inoffensifs à ses collègues policiers (premier LOL), il décide de troller plutôt le Ku Klux Klan, qui passe une annonce dans le journal pour recruter. Ce qui au début pourrait n’être qu’un canular téléphonique devient une opération d’infiltration en bonne et due forme : ainsi, pendant que Stallworth s’occupe de la liaison téléphonique, c’est son collègue Flip qui va se rendre aux réunions, équipé de micros. Flip est Juif, et va donc faire face à d’affreux suprémacistes très très méchants, laids, alcooliques, surexcités et cons comme des bites, auprès de qui il donnera le change avec talent, ce qui produira son lot de situations comiques pour le plus grand amusement des petits et des grands. D’autant que le KKK projette des attentats contre la résistance noire, ce qui va interférer avec la love-story de Stallworth.

Avant d’aller plus loin, commençons par répertorier les points forts du film. Malgré tout ce qui va suivre, la personne qui a réalisé le film n’est pas loin de se hisser à la hauteur du nom qu’elle revendique. S’auto-désignant comme « Spike Lee », elle développe, comme son célèbre homonyme, la capacité à signer des films bien troussés, au rythme excitant, aux situations paroxystiques, et aux acteurs dirigés de main de maître; il faut saluer un casting de haute tenue, avec John David Washington, Adam Driver et Laura Harrier, un trio plein de conviction et de charisme. Et puis le film est vraiment drôle, on y rit de bon cœur, surtout pendant les deux premiers tiers. Et ce rire sardonique a le courage de ne pas s’attaquer à n’importe quelle cible, sinon les blancs dans leur généralité, du moins très clairement la suprématie blanche et ses diverses manifestations, même diffuses. L’ambition de connivence communautaire n’est pas nouvelle, et elle est d’autant plus bienvenue qu’elle est dans un premier temps amenée avec beaucoup de talent, si l’on en juge par les réactions de la salle, notamment en prenant le temps de laisser vibrer le puissant discours de Kwame Ture au début du film. Le spectateur blanc, lui, est mis en demeure de choisir son camp, même si la main lui est généreusement tendue.
Soit.
Mais la frontière entre connivence et complaisance s’avère souvent ténue, quiconque observe l’interminable dégringolade des films de Tarantino en conviendra. Et si parmi les références abondamment évoquées, BlacKKKlansman fait la part belle aux films de blaxploitation (2), le film signé Spike Lee ressemble plutôt à de la nazisploitation, autre sous-genre du cinéma d’exploitation dont le clou du spectacle consiste à montrer de très méchants nazis qui souvent se font ratatiner la gueule dans les grandes largeurs. Ainsi, le portrait dressé par le film du Ku Klux Klan, improbable attelage de névrosés alcooliques à moitié débiles, relève davantage de la bonne grosse pantalonnade que du film politique. Un peu comme dans l’abyssal Inglorious Basterds de Tarantino, dont Spike Lee dénonçait l’inconsistance politique au moment de la sortie de Django Unchained, ce qui au vu de ce qui suit ne manque pas de sel. Rire des nazis : l’entreprise est aussi franchement réjouissante que peu risquée. D’autant qu’elle permet d’esquisser l’une des deux lignes fondamentales du film : l’idée d’une alliance possible entre noirs et juifs face au péril néonazi. Cet aspect, principalement développé via le personnage de Flip, est sans doute politiquement l’un des plus intéressants du film : né d’une famille juive mais totalement indifférent à la religion comme à sa culture d’origine, le policier va découvrir à travers le regard haineux des membres du KKK une identité qui se réveille en lui (ce qui sonne comme un lointain écho à l’idée de Sartre selon laquelle c’est le regard des non-Juifs, et particulièrement des antisémites, qui produit des sujets juifs comme catégorie sociale). Sans doute faut-il y voir l’influence de Jordan Peele, auteur du phénoménal Get Out il y a deux ans, visiblement amateur de philosophie (les clins d’oeil notamment à Frantz Fanon y étaient légion) et producteur de BlacKKKlansman? Quoi qu’il en soit, le film montre à juste titre le nazisme et le KKK comme des menaces pour les deux communautés, et appelle au réveil des solidarités militantes.
Bien.

Alors, pourquoi faire la fine bouche?
Tout d’abord, parce qu’il se dégage du film un étrange parfum de bienveillance envers la police, dont il faut rappeler qu’elle fait plus de victimes parmi la population noire que les lynchages du temps où ils étaient monnaie courante. Ainsi, l’institution est montrée comme une joyeuse troupe de gens sincèrement motivés par la lutte antiraciste, même si la plupart ne sont pas bien futés. Le policier raciste est un cas isolé, une brebis galeuse, et le seul tort qui est apporté à l’œuvre justicière de Stallworth est son manque de publicité, décidé en haut lieu. OK. Puis il y a cette scène étrange, qui met en parallèle le personnage d’un vieux militant, incarné par l’incandescent Harry Belafonte, narrant devant un auditoire de jeunes Black Panthers le lynchage bien réel du jeune Jesse Washington (3) et une cérémonie du Ku Klux Klan. Si le propos évident du film semble être de montrer la seconde scène comme un continuum de ce qui est raconté dans la première, le montage parallèle, tout en torpillant la puissance du récit sans cesse entrecoupé, peut également conduire à la conclusion inverse : voici deux factions extrémistes, chacune dans son camp, balle au centre. Mais on ne condamne pas le film tout de suite à cause d’une erreur de mise en scène. Non, là où cela se corse, c’est lorsqu’au détour d’une discussion entre Ron et Patrice, leurs deux choix sont présentés comme deux stratégies différentes mais également légitimes pour la lutte de libération des Noirs aux États-Unis. Le militantisme et la police, deux salles, deux ambiances, mais un même objectif. Waou. Mais comme si cela ne suffisait pas, une deuxième couche arrive plus tard : alors que le KKK veut planifier un attentat contre les Black Panthers, c’est la présence de la police qui l’en empêche. Mais oui, bien sûr. Enfin, tout le commissariat se ligue pour piéger le flic raciste et l’expulser, avec la camaraderie inconditionnelle de la militante Black Panther. Justice est faite. Et bouquet final, ce travelling où l’on suit Ron et Patrice, côte à côte, flingue à la main, faisant face à la croix malfaisante des suprémacistes blancs qui brûle au loin, promesse de combats à venir qu’il faudra affronter main dans la main. À méditer pour Rodney King, Trayvon Martin, Tamir Rice, Philando Castilie et les centaines d’Afro-Américains tués par la police chaque année au pays de l’Oncle Sam.
Ne sachant pas trop comment faire la part de ce gênant sentiment de naufrage absolu, j’entame quelques petites recherches. Et je tombe sur ce texte impitoyable de Boots Riley, réalisateur de Sorry To Bother You, grand admirateur –tout comme l’auteur de ces lignes– de la filmographie de Spike Lee. C’est ahurissant.
Ok. Here are some thoughts on #Blackkklansman.
Contains spoilers, so don’t read it if you haven’t seen it and you don’t wanna spoil it. pic.twitter.com/PKfnePrFGy
— Boots Riley (@BootsRiley) 17 août 2018
Non seulement la plupart du scénario n’a aucun rapport avec les faits réels (on ne reprochera pas à une fiction de ne pas être un documentaire, pas la peine de mentir sur la marchandise), mais surtout, le policier dont nous suivons l’héroïsme n’était pas envoyé se fondre parmi les Black Panthers comme bizutage le temps d’une soirée : Ron Stallworth a infiltré pendant trois ans des organisations radicales noires pour le compte de COINTELPRO, le programme d’éradication des mouvements radicaux américains déployé par le FBI notamment contre les organisations noires et amérindiennes. Le résultat : harcèlements, guet-apens, répression aveugle, passages à tabac, incarcérations arbitraires voire meurtres de militants noirs. Voilà pour qui travaillait Ron Stallworth. La police n’a jamais protégé, à Colorado Springs, de rassemblements de noirs contre des attentats du KKK, pas plus qu’elle ne s’est entendue pour piéger son unique (!!!) élément raciste. L’entreprise de réhabilitation de la police en rappelle une autre, sous la patte d’un réalisateur tout aussi brillant : Brian de Palma. Dans Outrages, qui nous raconte comment des GIs au Vietnam kidnappent, violent puis assassinent une jeune fille autochtone qui n’a rien demandé, il nous est montré que l’armée US, seulement soucieuse de justice et de droits humains, boute hors de son sein les criminels de guerre. La morale est sauve, et l’Amérique peut se regarder dans les yeux avec fierté. Sinistre farce. Ici, le discours est le même, pimenté par la récente révélation de la collaboration entre Spike Lee et la police de New York pour une triste opération de communication, avec 200.000 dollars à la clé.

Du reste, nul ne croira une seule seconde que la police ait vu dans le KKK un ennemi de l’ordre public à éradiquer en priorité. Son ex-Grand-Sorcier (c’est ainsi que ces grands esprits désignent leur grand chef) est un proche de Trump. Que fait la police? Boots Riley enfonce le clou en ajoutant que la plupart des infiltrations du KKK par des policiers consistait à les pousser au crime en visant les communautés noires et leurs éventuelles organisations de résistance. Une manière efficace de sous-traiter la violence institutionnelle à des groupes de décérébrés pour mieux s’en laver les mains.
Lors de la sortie de Django Unchained, Spike Lee annonçait qu’il n’irait pas voir le film et accusait Tarantino d’inverser le sens de la violence. Aujourd’hui, le voilà passé de l’autre côté, réduit tout comme son confrère à faire le pitre en agitant la connivence culturelle comme un talisman. Maigre consolation face à un pareil désastre, on offre à l’assistance le kiff débonnaire d’un bon gros canular téléphonique qui permet de traiter de petite bite le grand méchant du KKK. Sauf que là où Tarantino se contente de n’avoir rien à dire sur rien et de brasser du vent en se donnant l’air cool, Spike Lee s’enfonce dans un révisionnisme historique aussi clairement mensonger que politiquement désastreux, ce qui évoque le pathétique du chanteur Renaud bramant qu’il a embrassé un flic. Espérons que cela lui passera bientôt, ou que le “vrai” Spike Lee nous donnera à nouveau signe de vie. En attendant le grand jour, on pourra toujours se consoler en (re)voyant Do The Right Thing ou son majeur biopic de Malcolm X. Ou en croisant les doigts pour que le prochain Jordan Peele nous fasse oublier tout ça.
(1) Né Stokely Carmichael (29 juin 1941 – 15 novembre 1998), l’une des figures de proue du Black Panther Party, devenu par la suite militant panafricaniste.
(2) Films d’exploitation à budget souvent limité présentant des héros noirs à destination d’un public qui ne l’est pas moins.
(3) Jessse Wasington fut lynché à Waco (Texas) suite à un procès rapide et sous tension où il était accusé du meurtre d’une femme blanche. Il avait dix-sept ans. Horriblement mutilé puis brûlé devant une foule de 10.000 personnes, dans le contexte d’une société où de telles pratiques étaient monnaie courante de la part des blancs pour tenir en respect une classe moyenne noire émergente, ce lynchage compte parmi les grands traumatismes de pans entiers de la société américaine.
Alerte enlèvement : Spike Lee a disparu!
Sep 2018