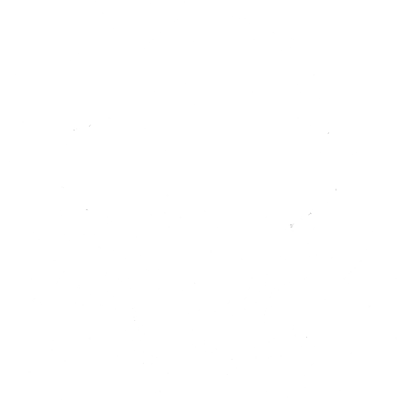:))))))))))))
Peut-on se planter lorsque l’on investit 35 millions de dollars (un peu plus que le budget d’Apocalypse Now) pour adapter l’un des romans les plus célèbres et effrayants d’un auteur au succès pharaonique, avec un réalisateur jeune et talentueux à la baguette et le chef opérateur d’Old Boy derrière la caméra ?
Alors que la nouvelle adaptation de Ça vient de détrôner L’Exorciste sur le podium commercial des films d’horreur aux USA et que l’âne Dolan se prosterne devant « le film du 21ème siècle », Mauvais a décidé de mener l’enquête.
« Allez voir ‘Ça’ – pour l’amour de votre enfance, pour les craintes que vous avez cachées et que vous n’osiez pas exprimer. Pour la beauté extrême, modeste et magistrale de la photographie et des décors, pour l’amusement, pour le plaisir sans gêne et sans culpabilité, pour l’esprit, pour Finn Wolfhard, Jaeden Lieberheet et tous les autres, allez le voir … pour TOUT. ‘Ça’ est ce que le divertissement devrait toujours être, et aussi ce qu’il atteint si rarement.Tous les films devraient avoir des normes afin de vous traiter avec respect pour votre goût et votre intelligence. »
C’est sur Instagram que l’embarrassant réalisateur Xavier Dolan nous livre son verdict au sujet du second film d’Andrés Muschietti. En d’autres termes : craintes refoulées + bons acteurs + jolie photographie = film du 21ème siècle. Et, conclusion mise à part, on ne peut que lui donner raison.
Si les mérites de l’intrigue et de ses ressorts puissants qui plongent leurs racines dans des peurs ancestrales liées à l’enfance et à l’histoire des Etats-Unis appartiennent à Stephen King, le moins que l’on puisse dire est que cette adaptation ne les a pas trahis. C’est en soi un premier exploit, notamment si on se souvient de l’adaptation de Tommy Lee Wallace en 1990, plus cheap que réellement kitsch, et dont seule la prestation de Tim Curry sauvait de l’ennui. Car l’écriture de Stephen King, aussi peu conventionnelle soit-elle, déploie déjà une telle puissance d’évocation, et use de ruses littéraires si peu taillées pour le cinéma que plus d’un cinéaste s’est cassé les dents en essayant de l’adapter. Pour un Shining, un Dead Zone, un Carrie (les plus audacieux), ainsi qu’un Stand By Me et un Misery (plus classiques), des dizaines de naufrages, allant du ratage avec des intentions douteuses (La Ligne Verte) à la nullité la plus absolue (Simetierre).

S’il est évident qu’on n’adapte pas huit cent pages en deux heures et quart de film sans quelques simplifications, ce qui marque dans le film de Muschietti, c’est qu’on y a préservé non seulement la face purement horrifique, moteur de l’ambition commerciale du projet, mais également le portrait cru d’une Amérique brutale, où la jeunesse et la raison ne s’imposent que par le combat, tout comme le rapport trouble à un passé pourtant jeune d’une société construite sur d’incessants bouleversements. Mais sur ce point particulier, le film s’arrête à mi-chemin. Là où le texte de King ne tourne pas autour du pot pour décrire le harcèlement continuel que subissent Ben à cause de son embonpoint, Beverly non seulement parce qu’elle est supposée facile mais aussi simplement parce qu’elle est une fille, et enfin Mike parce qu’il est noir, le film se contente d’en faire les proies arbitraires d’une bande d’ados menés par Henry Bowers, un « méchant » absolument caricatural dénué de la moindre profondeur. À vrai dire, de racisme il n’est explicitement jamais question dans le film. Mike est noir, c’est entendu, mais il subit un harcèlement abstrait. On peut s’interroger, dans un contexte de retour de l’ordre moral, sur la signification de cette régression.
Cela étant, les soubassements dramatiques du film reposent bel et bien sur cette incertitude ancestrale des colons européens arrivés sur le continent américain, et hantés par un espace hostile. Incertitude que l’on retrouve également dans d’autres classiques du genre (du séminal Projet Blair Witch au plus récent et ténébreux The VVitch) et ressurgit ici par petites touches distillées avec le soin qu’il faut pour faire leur effet.
Tout aussi louable est le maintien de dialogues ultra-crus, faits de concours de bite, de blagues sur ta mère, d’insultes XXL et autres grivoiseries, qui nous plongent dans une enfance réellement vécue bien davantage que dans les perpétuels portraits de jeunesses idéalisées que le cinéma grand public véhicule volontiers. Dialogues sans doute rendus acceptables et bankable par le boom des séries américaines, qui travaillent depuis le début du siècle des terrains que le bon vieux cinéma avait tendance à délaisser.

Tout cela est porté par un casting irréprochable de jeunes acteurs pétaradants, qu’il s’agisse de l’intempestif Tim Folfhard (Richie), d’un Jeremy Ray Taylor parfaitement mal à l’aise dans le rôle de Ben ou de l’époustouflante Sophia Lillis, qui dévoile insatiablement toutes les ambiguïtés du personnage de Beverly Marsh, de loin le plus consistant. À toutes ces qualités il faut ajouter une direction artistique qui ne lésine pas sur les effets pour susciter les frissons, tout en flattant les pupilles grâce à une photographie irréprochable et un univers visuel référencé, sans surprises, mais totalement maîtrisé.
Alors, d’où vient ce sentiment d’insatisfaction, ce manque d’un quelque chose qui fait hésiter lorsque l’on s’entend demander : « alors, c’était bien ? »
À cette question, on ne peut répondre qu’en en posant une seconde : qu’est-on en droit d’attendre de l’adaptation de Stephen King signée Muschietti et produite par New Line Cinema ?

Shining, de Kubrick, également d’après Stephen King
On ne peut pas totalement évacuer une première objection : quand on adapte Stephen King, on est en droit d’attendre de la radicalité cinématographique ; des parti-pris obsédants (la steadycam le long des couloirs dans le Shining de Kubrick), une horreur qui naît par accumulation ou par détails (Misery), de l’audace dans les choix esthétiques (Carrie). Quelque chose d’inoubliable, une terreur que l’on emporte durablement avec soi. Las ! La maîtrise totale exhibée comme un trophée par Muschietti (celle-là qui lui permet de diriger un projet à 35 millions de dollars) a son pendant négatif : à trop miser sur les recettes sûres (omniprésence d’une musique aux gimmicks battus et rebattus, débauche de jump-scares, trop rares moments où l’horreur repose réellement sur la mise en scène et sur la capacité du film à prendre le temps d’installer un sentiment d’angoisse), le film en oublie d’être autre chose qu’une boîte à sursauts dans un emballage aux jolies couleurs. L’absence de défauts techniques est érigée en qualité, là où on pouvait attendre des idées fortes à la place des sempiternels gadgets visuels et sonores qui font sauter sur place puis passer à autre chose.
Mais après tout, un peu comme le porno, le genre horrifique n’est pas tenu de proposer du « grand cinéma », pourvu qu’il fasse de l’effet. C’est sans doute à cela que se réfère l’âne Dolan lorsqu’il parle de « divertissement » (« entertainment » en anglais), ce mot par ailleurs horripilant, qui renvoie au rôle exclusivement fonctionnel des arts dans le mode de vie bourgeois : occuper les braves gens. Admettons que l’on s’y tienne. Ça fait-il passer le temps ? Oui, et de manière plutôt agréable. Fait-il peur ? Parfois un peu, quoique de manière superficielle. Cesse-t-on de dormir après l’avoir vu ? Certainement pas. Bref, on est pris par la main (et par l’oreille) pendant deux heures et quart qui nous soustraient sans heurts à toute angoisse existentielle. Certes, on frissonne de temps en temps, mais on est bien loin de ce que le cinéma d’horreur, y compris contemporain, peut proposer de plus glaçant, qu’il s’agisse de l’indépendant It Follows, de l’artisanal autant qu’australien Babadook ou encore du fascinant et abominable Martyrs, où justement Xavier Dolan en personne se fait refroidir au bout de dix minutes de film.

Évidemment, on peut imaginer que le rôle d’un film grand public, fût-il d’horreur, ne soit pas non plus de faire fuir ses spectateurs par trop d’émotions pour leurs petits cœurs fragiles, et que ce registre « radical » soit à réserver à juste titre à un cinéma indépendant. Il existe pourtant un cinéma grand public exigeant et horrifique à la fois, de Ring à Sinister en passant par The Descent, qui sans autre prétention que de susciter la peur, parvient à troubler le spectateur au-delà du jump-scare. On peut d’ailleurs en dire autant de l’excellent premier film de Muschietti, Mama, qui malgré un budget tout à fait correct, n’hésitait pas à recourir à des procédés esthétiques « artisanaux » pour faire monter la sauce, tirant les leçons des nombreux succès du cinéma d’horreur asiatique tout en l’adaptant à la réalité géographique et culturelle des Etats-Unis. Las ! Il semble que pour complaire à la manière paternaliste dont les majors s’adressent à leur public, supposé aussi massif que décérébré, il faille jeter par-dessus bord et avec toute prétention artistique véritable, jusqu’à l’idée de faire perdurer la peur quelques nuits après la séance de ciné.

Mama, première bombe d’Andy Muschietti
Muschietti n’est pas le premier à chercher la consécration à travers une bonne grosse prod, et il n’est pas non plus le moins talentueux. Ne pas trop trahir Stephen King, diriger avec brio des acteurs jeunes et capter quelque chose de la brutalité de l’Amérique sans ennuyer pendant plus de deux heures est agréable. Mais on peut attendre de lui, et des adaptations du King, quelque chose de plus ambitieux. Suite au deuxième épisode ?

“Ça” ne casse pas trois pattes à un canard
Oct 2017